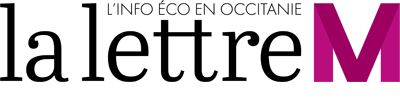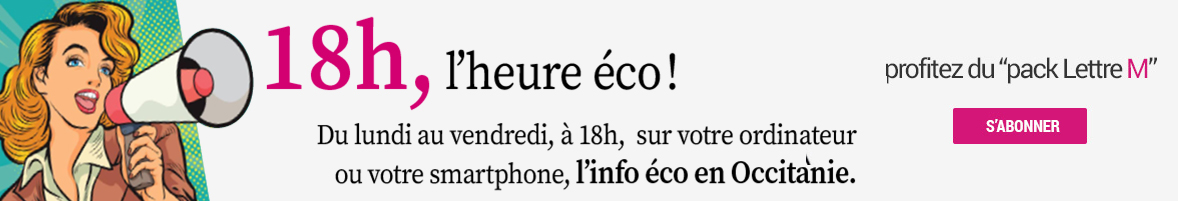Prospective : l’Occitanie à l’ère de l’économie symbiotique
« Imaginons-nous dans quinze ans… Nous sommes en Occitanie ». C'est ainsi qu'Isabelle Delannoy, théoricienne de l’économie symbiotique (un modèle économique régénératif qui associe écosystèmes naturels prospères et activité humaine intense), a invité ses auditeurs à se projeter à l’occasion d’un événement organisé le 7 avril par la Cité de l’économie et des métiers de demain à Montpellier, destiné à « repenser les relations entre l’économie et le vivant ».
« Nous avons entamé un nouveau développement. Le vrai tournant s’est produit après la grande pandémie », rappelle Isabelle Delannoy, qui recense dans un scénario prospectif une multitude d’initiatives déjà expérimentées dans diverses régions du monde. Elle imagine par exemple « la ville du quart d’heure », dans laquelle tous les services, commerces et jardins sont disponibles dans un rayon de quinze minutes à pied. Les jardins, parcs et bassins y ont un rôle de cuves contre les inondations, de chargeurs de nappes phréatiques ou encore de centrales d’épuration. Dans cette nouvelle cité, les transports verts ou les déplacements à pied sont légion et les rares voitures sont partagées. Dans ce contexte, l’achat est redevenu local, avec à la clé une création de richesses sur le territoire.
Les paysages ont muté : la ville et les surfaces agricoles - notamment maraîchères - se mêlent, et l’agriculture majoritaire est désormais biologique. Malgré la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires, les agriculteurs ont trouvé des solutions dans la nature. L’agroforesterie qui s’est développée permet d’alimenter les filières régionales de la construction bois ou du bois de chauffage pourvoyeuses d’emplois.
Un véritable soutien aux PME s’est développé, avec la mise en place de plateformes collaboratives et open source pour les entreprises du territoire. Les citoyens sont devenus investisseurs dans les entreprises locales - artisans, agriculteurs, producteurs d’énergie - prenant des parts via des plateformes de crowdfunding dédiées. L’industrie a totalement changé ses pratiques. De l’électroménager aux smartphones en passant par les voitures, tout est devenu modulaire, avec des pièces qui s’assemblent et se désassemblent – localement - en fonction des besoins. Et ce sont sur ces besoins que les collectivités locales se sont appuyées pour enclencher les changements nécessaires : « Partir des besoins, adopter des solutions régénératives des ressources et ouvrir l’investissement », explique Isabelle Delannoy qui rappelle l’importance du partage du savoir et des expériences pour avancer.
L'humain créateur de biodiversité
Selon l’ingénieure, l’entrée en réseau, c’est-à-dire les interactions humaines et entre l’humain et la nature, constituent la clé de la réussite de l’économie de demain. Elle rappelle d’ailleurs que selon une étude menée par le MIT, 77 % des innovations réelles dans l’industrie viennent non pas des industriels mais des usagers qui font part de leurs besoins. Autre principe fondamental selon elle : « Rechercher l’efficience maximale, c’est-à-dire raccourcir les distances, réutiliser au maximum la matière » et optimiser l’usage de l’énergie. Enfin, l’impact de l’activité humaine sur l’environnement et le vivant doit absolument être étudié et évité s’il est négatif.
Un avis partagé par Cyril Dion, écrivain, poète, écologiste et réalisateur, qui s’apprête à sortir un nouveau film intitulé Animal. Il y présente des exemples de conséquences néfastes de l’activité humaine sur l’environnement, mais démontre également que l’humain peut jouer un rôle non pas de destructeur mais de « créateur de vivant augmenté », en accélérant la création de biodiversité, d'autant plus que celle-ci a une réelle utilité économique. Le réalisateur cite l’exemple du Costa Rica, qui après avoir engendré une large déforestation pour l’élevage et la culture du soja a décidé de « ré-ensauvager » son territoire en replantant massivement des arbres. « En 40 ans, le Costa Rica est passé de 20 % à plus de 50 % de couvert forestier, et a fondé un modèle économique basé sur la valorisation des services écosystémiques et sur le tourisme », explique Cyril Dion.
La Région en marche pour « la bascule du modèle »
Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie, en charge de la transition écologique et énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets, qui suivait l’événement organisé par la Cité de l’économie et des métiers de demain, s’est dite très intéressées par toutes ces initiatives et a rappelé que la Région agissait pour « cette bascule du modèle » économique, notamment à travers son Pacte Vert. Elle a d'ailleurs rappelé que la Région avait lancé une plateforme de financement participatif telle que celle décrite dans le sénario d'Isabelle Delannoy. Convaincue que de multiples initiatives existent localement, elle souhaite que la Région poursuive dans son rôle d’ « assemblier », c’est-à-dire de catalyseur des actions publiques et privées qui existent en Occitanie afin de faire de celles-ci « le modèle dominant ». Néanmoins, pour changer de paradigme, Agnès Langevine estime essentiel de modifier les indicateurs de performance et de « trouver d’autres types d’outils d’évaluation que le seul PIB ».
Quid de la culture symbiotique ?
Invité par la Cité de l’économie et des métiers de demain à l’événement prospectif du 7 avril, Vincent Cavaroc, directeur de la Halle Tropisme à Montpellier, estime qu’au-delà d’une « économie symbiotique », il peut exister « une culture symbiotique alternative au modèle capitalistique, consumériste et énergivore de la culture ». Celle-ci irait « moins vers l’événementiel et plus vers le structurel » en créant des équipements qui font sens dans la durée, tels que les tiers lieux.
De son côté, l’artiste et apiculteur Olivier Darné, croit en l’importance de transmettre des messages par l’art. Fondateur du collectif d’artistes le Parti Poétique, il travaille à la « pollinisation de la ville, c’est-à-dire comment poser des questions et des abeilles dans l’espace public ». Selon lui, les abeilles ont des leçons à apporter aux humains car « la ruche est un écosystème en relation avec les autres ecosystèmes. Les abeilles enseignent un art de la relation ».