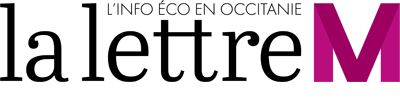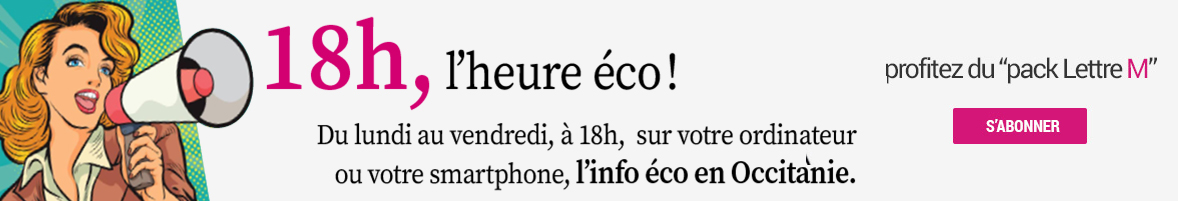Inclusion : manager les talents neurodivers
Face à l’intensification des crises et de l’incertitude, il faut repenser les dispositifs de détection et d’accompagnement des talents. Les capacités d’adaptation et de résilience deviennent les soft skills indispensables pour le futur. Alors que les neurodivers, qui représentent 15 à 20 % de la population, paraissent mieux armés pour s’adapter à l’incertitude et innover, seule une entreprise sur dix se préoccupe de leur inclusion. Une tribune de Julien Granata, responsable du Master of Science Management des Ressources Humaines à MBS School of Business.
Le mouvement pour la neurodiversité démarre dans les années 1990 pour accroître l’inclusion de tous en tenant compte des différences neurologiques. Sont considérées neurodiverses – ou neuroatypiques – les personnes atteintes d’un trouble du neurodéveloppement (TDAH, TSA, Dys) et les HPI. Mais pour exprimer leur plein potentiel, les neurodivers ont souvent besoin au travail d’aménagements spécifiques qui ne leur sont pas toujours attribués ou, pire, les stigmatisent. Dès 2017, dans la Harvard BusinessReview, Robert D. Austin et Gary P. Pisano publient l’article Neurodiversity as a Competitive Advantage. Les auteurs y montrent qu’un nombre croissant d’entreprises de premier plan (Microsoft, Ford, Caterpillar, Dell, UBS, JPMorgan…) ont réformé leur processus RH afin d’attirer des talents neurodivers. Les premiers résultats de ces programmes détonent : gains de productivité, amélioration de la qualité, renforcement des capacités d’innovation, moindre sensibilité au désordre et plus grande ouverture aux opportunités permettant de réagir plus rapidement aux besoins des clients. D’autres effets positifs indirects sont à souligner, comme une amélioration de la sensibilité à la prise en compte des besoins de tous les salariés par les managers, une baisse du turnover et une meilleure réputation pour l’attraction des talents.
Alors pourquoi les entreprises ne se lancent-elles pas dans la course aux neurodivers ? La faute à des parcours talents majoritairement orientés vers les HiPo (High Potential), que l’on reconnaît comme les futurs directeurs en se figeant sur les attendus du présent alors que nul ne peut prédire le futur. Un second écueil vient des managers qui, sous contrainte de performance, appréhendent les publics plus vulnérables sous l’angle de la contrainte. De plus, les comportements des neurodivers vont parfois à l’encontre des idées reçues sur ce qui fait un bon employé, comme la bonne communication, l’esprit d’équipe, l’aptitude à réseauter et à se conformer aux pratiques courantes. Alors que les process RH visent une application à grande échelle, les neurodivers ont besoin d’aménagements spécifiques comme des bureaux individuels, des espaces calmes de ressourcement, des temps de pause réguliers et une individualisation de la relation managériale. Les expériences hors Hexagone réussies montrent que les entreprises en avance aident les universités à mettre en place des programmes d’amélioration de l’expérience professionnelle et des méthodes d’identification spécifiques des neurodivers pour faciliter leur attraction et leur intégration durable. Les grandes écoles et universités françaises, qui favorisent l’intégration et la promotion de ces publics, sont trop peu nombreuses et les actions déployées encore loin des programmes cités ci-dessus. Néanmoins, le premier collectif interentreprises francophone (Capgemini, Engie, EY, FDJ, L’Oréal, Orange, LVMH, Schneider, Siemens, Thales), dédié à la prise en compte de la neurodiversité, est lancé en 2024 sous l’égide « Objectif Neuroinclusion ». Les PME et TPE peuvent tout autant tirer leur épingle du jeu à condition de collaborer et de nouer des partenariats durables et éthiques, dans le respect des personnes et non pas leur exploitation, avec les instituts du supérieur de leur territoire.