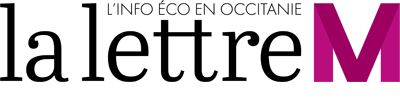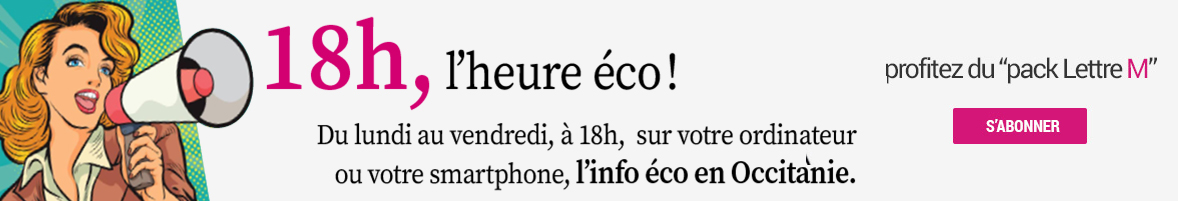Urbanisme, mobilités, soutien aux entreprises... : Michaël Delafosse et Jean-Luc Moudenc se livrent à La Lettre M
[Exclusif] Pour la toute première fois et en exclusivité pour La Lettre M, Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, et Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, se prêtent à l'exercice de l'interview croisée. Au menu : développement économique, soutien aux entreprises, grands projets de mobilités, urbanisation, sujet – sensible – du financement et enjeux de coopération entre les deux grandes métropoles d'Occitanie.
En quelques mots, quel regard portez-vous chacun sur les atouts de la métropole de l'autre ?
Michaël Delafosse : Je n’ai pas de difficulté à dire beaucoup de bien de la métropole de Toulouse, de sa douceur de vivre et de sa dynamique industrielle liée à l’aéronautique, mais pas uniquement. Au-delà, si sa taille est plus importante que celle de Montpellier, elle connaît la même dynamique démographique et ne manque pas d’atouts, notamment en termes de qualité de vie…
Jean-Luc Moudenc : Les atouts de la métropole montpelliéraine, qui fait partie des plus dynamiques de France, sont nombreux. L'un d'entre eux – que nous partageons, d'ailleurs – est la force de son enseignement supérieur. Nous sommes des territoires de connaissance ; après la Sorbonne, c'est à Toulouse et à Montpellier qu'ont été fondées les premières universités de France... Les succès de la métropole montpelliéraine reposent également sur la dynamique de certains secteurs comme la santé, l'agronomie, les biotechnologies ou encore le numérique. Autant de filières dans lesquelles la collectivité a investi de longue date. Enfin, Montpellier a un atout dont Toulouse ne dispose pas : la grande vitesse ferroviaire, qui la relie à Paris en trois heures et demi.
Quels sont les enjeux de développement économique de vos territoires respectifs ?
M. D. : Les défis que nous devons relever sont de trois ordres. Il faut tout d’abord quitter le modèle de développement reposant sur l’économie résidentielle pour aller vers celui de l’économie productive. C’est un enjeu majeur qui s’appuie sur un système d’incubation des entreprises dans des filières telles que le numérique, la santé ou les industries culturelles et créatives (ICC). Le second défi est lié à notre taux de chômage, supérieur de trois points à la moyenne nationale. Cette situation nous impose d’intensifier nos efforts en faveur du développement économique et de l’emploi afin de rendre notre métropole plus inclusive. Nous devons enfin boucler les projets d’infrastructures qui concourent à notre attractivité. Notre métropole est déjà dotée de la LGV (ligne à grande vitesse entre Montpellier et Paris, NDLR) et d’un aéroport, mais nous n’avons pas encore de contournement routier. Il faut également amplifier nos actions pour mieux coopérer avec le port de Sète, par exemple.
J.-L. M. : Tout d'abord, il s'agit de conforter nos positions là où nous sommes les plus forts. Nous sommes par exemple en tête en ce qui concerne l'aéronautique et le spatial, mais ce serait une erreur grossière de croire que ce classement est éternel. A l'heure de l'économie globale et de la concurrence féroce qui existe entre les territoires, conserver notre place est un combat. Par ailleurs, il ne faut pas tomber dans le risque de la mono-industrie ; il est important de se diversifier. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années, dans la santé et le tourisme, notamment, afin de produire toujours plus d'innovation et d'emplois. Pour être en mesure d'accueillir et de structurer ce développement, pour conforter les acteurs existants et développer de nouvelles filières, il nous faut fournir des adresses économiques. Pour cela, avec une vision très prospective, nous prévoyons des fonciers dédiés. Enfin, il est impératif que ce développement économique bénéficie à tous. Aujourd'hui, certains habitants de notre territoire demeurent en marge du succès toulousain. Nous devons le diffuser le plus largement possible.

© Ville de Montpellier
Comment accompagnez-vous les entreprises ?
M. D. : Le soutien aux entreprises constitue un enjeu immense, car c’est soutenir l’emploi. Notre stratégie s’appuie d’abord sur l’accompagnement et le soutien à la création d’entreprise avec le Bic (Business innovation center) de Montpellier, classé au troisième rang des incubateurs au niveau mondial. Deuxièmement, cela passe par l’animation de l’écosystème de nos filières stratégiques : numérique, énergies renouvelables et santé. L’objectif est d’aider les entreprises à se développer. Autre aspect de ce soutien aux entreprises, les accompagner dans leur implantation avec la recherche de foncier à vocation économique. Dans ce domaine, nous avons enfin adopté le 16 juillet notre PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal, NDLR) identifiant 300 hectares consacrés au développement économique. L’objectif de la Métropole est d’aider les entreprises du territoire à croître et les entreprises extérieures à s’implanter, à l’image de l’installation du groupe allemand Cykero, spécialisé dans le recyclage de smartphones, d’ordinateurs ou de serveurs informatiques, qui va transférer le siège social de sa filiale française.
J.-L. M. : Nous activons plusieurs leviers en vue de soutenir la création d'entreprise et d'accompagner les acteurs économiques. Il y a tout d'abord, je l'ai dit, la mise à disposition d'adresses économiques, avec 5 000 hectares répartis en 120 zones d'activités. Nous souhaitons par ailleurs accompagner l'incubation. Actuellement, quelque 90 entreprises sont hébergées dans nos 40 000 m2 de pépinières. Je pense notamment, côté aéronautique, au B612, et côté santé, au centre Pierre Potier. Nous animons également, avec la CCI Toulouse 31 et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, le dispositif « Mon entreprise pas à pas », qui permet d'aider les entreprises et les porteurs de projets dans leurs démarches puis leur évolution. Dans le champ de l'économie sociale et solidaire, nous proposons un dispositif d'incubation dédié. Et enfin, dans le cadre de notre Pacte Climat 2030, nous accompagnons les entreprises dans leurs démarches de transition écologique.
Vos deux métropoles ont pour point commun d'être particulièrement attractives. Quels sont vos objectifs en matière de construction de logements ?
M. D. : Dans ce domaine, l’adoption de notre PLUi est très importante. Nous évoluons dans un environnement réglementaire changeant. De fait, ce document fixe une vision du territoire et des règles d’aménagement pour les quinze prochaines années. L’un des grands enjeux est de continuer à accueillir des habitants. Les entreprises en phase de création ou de développement ont besoin de compétences, qu’elles soient recrutées localement ou qu’elles viennent d’ailleurs. Nous assumons donc la construction de logements destinés à accueillir cette croissance démographique et économique. Mais cette urbanisation ne se fera plus comme avant, avec l’artificialisation des sols, le modèle du lotissement ou l’extension vers les zones périphériques : 85 % de la production de nouveaux logements programmée dans le cadre du PLUi sera assurée par du réinvestissement urbain, dans des zones déjà artificialisées. Nous avons désormais la capacité d’atteindre une moyenne de production de l’ordre de 4 000 logements par an. Comme je l’indiquais, plusieurs zones sont par ailleurs dédiées à l’activité économique dans ce document, avec des quartiers à vocation tertiaire en plein développement, comme celui de Cambacérès, autour de la gare TGV.
J.-L. M. : De notre côté, nous allons concrétiser en décembre prochain une démarche engagée depuis plusieurs années, avec l’entrée en vigueur de notre PLUi-H (Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme local de l'habitat, NDLR). Dans ce cadre, notre objectif tient en deux chiffres : nous devons être en mesure, d'ici à 2035, d'accueillir 9 000 habitants supplémentaires chaque année, ce qui impliquera de construire en moyenne 7 300 logements par an dans le territoire métropolitain. 60 % d'entre eux seront encadrés : il s'agira à 35 % de logements sociaux et à 25 % de logements en accession sociale à la propriété ou à prix maîtrisés. En parallèle, au travers du foncier économique, nous devons être capables d'accueillir annuellement 5 000 emplois supplémentaires. Avec ce nouveau PLUi-H, nous sommes parvenus à dépasser les clivages politiques puisque tous les maires de Toulouse Métropole l’ont approuvé. Et ce sera le premier plan d’urbanisme bioclimatique d’une métropole française ; c'est un effort considérable qui est fourni par les maires du territoire, alors même que nous étions déjà très vertueux, puisque nous sommes la sixième métropole de France d'un point de vue démographique, mais seulement la quatorzième pour la consommation foncière.

© Pixabay
A l'heure du Zéro artificialisation nette (Zan), faut-il repenser l'urbanisme ? Comment concilier, à l'échelle métropolitaine, nécessité de bâtir et enjeux environnementaux ?
M. D. : Là encore, il n’est plus possible de penser la ville comme avant compte tenu de la réalité du changement climatique. Il faut évidemment agir pour réduire nos émissions de CO2, ce qui est un impératif. Les métropoles doivent y contribuer. Il faut en premier lieu rafraîchir nos villes pour nous adapter à ce changement. Nous ne pouvons plus construire de la même manière. La question de la densité se pose donc, comme celle des mobilités et de la part des déplacements automobiles. Notre PLUi intègre des règles limitant à 50 % l’imperméabilisation des sols et protégeant les plantations d’arbres et la canopée. Nous avons également introduit des dispositions pour que les appartements neufs soient traversants afin d’améliorer leur confort thermique. Et comme à Toulouse, dont nous nous sommes inspirés, tout projet immobilier de plus de 300 m2 doit produire sa propre énergie. Plus largement, le Zan est une trajectoire nécessaire. Nous nous impliquons en réduisant de 50 % notre artificialisation. Notre PLUi préserve désormais deux tiers des espaces naturels et agricoles de notre territoire, avec un tiers dédié à l’urbanisation. Celle-ci devra se faire à proximité des infrastructures de transport et d’espaces naturels afin de garantir la qualité de vie.
J.-L. M. : J'approuve le principe d'aller vers le Zéro artificialisation nette des sols. Mais de mon point de vue, la loi est trop drastique et ne fait pas la différence entre les territoires qui, comme nous, étaient déjà très vertueux et se développent beaucoup, et les autres. A aucun moment les maires et présidents d'intercommunalités n'ont été associés à l'élaboration de cette loi, que l'on nous charge pourtant de mettre en œuvre. Pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'étalement urbain, cela fait bien longtemps que nous ne le pratiquons plus. Nous avons l'habitude de renouveler la ville sur elle-même. Dans la perspective du Zan, la seule solution est de construire plus haut. Mais ce n'est pas évident, car ce n'est pas ce que les habitants souhaitent. L’enjeu consiste donc à faire adhérer nos concitoyens à cette urbanisation aux contours différents. Pour cela, je vois deux conditions indispensables : d'une part, que le « haut » ne soit pas perçu comme quelque chose de laid, en opérant un saut qualitatif sur le plan architectural, et d'autre part, que le foncier libéré soit végétalisé pour constituer un bénéfice direct pour les habitants et le rafraîchissement de la ville.
Sur le front des transports en commun, vos approches sont différentes. Lorsque la métropole toulousaine investit massivement dans une troisième ligne de métro, celle de Montpellier fait le choix de la gratuité. Comment résumeriez-vous vos stratégies respectives ?
M. D. : Dans la métropole de Montpellier, le choix est très fort avec la gratuité des transports. Cette mesure s’inscrit dans une transformation systémique des mobilités à l’échelle métropolitaine. Elle vise à réduire significativement la place de la voiture. Je ne suis pas pour une écologie punitive mais pour une écologie positive. La gratuité est un moyen de répondre aux formes importantes de pauvreté et aux gens qui peinent à vivre de leur travail. La gratuité s’accompagne aussi du développement de l’offre de transport, avec trois infrastructures livrées ou en cours de livraison : mise en service de la première ligne de bustram avec l’objectif de développer cinq lignes au total, livraison de la cinquième ligne de tramway en décembre et extension de la première ligne en octobre. Nous accordons également une place très importante au vélo, ce qui a nécessité un partage de l’espace pour sécuriser sa pratique. Ces choix en termes de mobilité contribuent à la qualité de vie mais permettent surtout de tenir les objectifs de transition environnementale. La gratuité s’inscrit dans cette volonté de changer de modèle. Très clairement - et c’est une chance -, nous avons pu mettre en œuvre et prendre en charge cette mesure grâce au dynamisme de nos versements mobilités.
J.-L. M. : De notre côté, nous avons fait le choix, dans le cadre d'un accord transpartisan, de ne pas retenir l'idée de la gratuité des transports en commun. Car l'instaurer représenterait un manque annuel de recettes de 130 M€. Nous avons pris le parti d'un plan d'investissement fort, avec davantage de métro, de tramway, de bus, mais aussi le téléphérique urbain et les cars express. Nous activons des leviers différents en fonction des caractéristiques et des niveaux de densité de chacun des territoires. Aujourd'hui, hormis Paris, la métropole toulousaine est celle qui investit le plus dans les transports en commun. Cela correspond aux besoins exprimés par la population : lorsque je discute avec les gens, ils ne me demandent pas des transports gratuits, mais davantage de bus !
Vos deux métropoles pourraient chacune se doter d'un Serm (Service express régional métropolitain). Quels sont les enjeux de ces projets pour vos territoires ?
M. D. : C’est un dossier stratégique. Un président de métropole a la compétence transport mais uniquement sur son territoire. Or, notre bassin de vie est bien plus important. Les Serm permettent donc d’avoir une vision plus large. Celui de Montpellier a ainsi fait l’objet d’un consensus autour d’une cartographie de l’offre de transport conçue à grande échelle. Des dossiers avancent, d’autres se préparent et certains vont nécessiter une mobilisation. Celui qui avance concerne le projet de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Béziers. Il va permettre d’avoir un meilleur cadencement des TER vers l’ouest de la métropole, en direction de Sète. Mais Montpellier n’a pas d’étoile ferroviaire. Notre Serm se pense donc notamment avec des lignes de car express à grande échelle, avec le développement des pôles d’échanges multimodal de Gignac ou de Lodève. L’un des enjeux est de faire en sorte que ces lignes puissent être performantes en incitant les habitants à ne plus utiliser leur voiture. Les études sont lancées avec l’accompagnement de la société des grands programmes. Mais actuellement, nous n’avons pas de lisibilité financière sur le financement des Serm, ce qui constitue une limite à ce projet.
J.-L. M. : Concernant le Serm, deux sentiments m'habitent : je suis favorable, mais prudent. Favorable au projet, tout d'abord, parce que l'idée du Serm est, en mobilisant tantôt le ferroviaire, tantôt les cars express, d'aller chercher des personnes qui vivent à trente, quarante ou cinquante kilomètres de la ville centrale de la métropole et réalisent des trajets pendulaires quotidiennement en voiture. C'est une bonne idée, bien entendu. Mais je suis prudent, car jusqu'alors, je constate que l’État n'a financé que quelques morceaux d'études, mais n'est absolument pas au rendez-vous sur le plan financier. Or, les projets de ce genre coûtent très cher. Pour Toulouse, on parle de 4,2 Md€ d'investissement ferroviaires et de coûts de fonctionnement annuels de 110 M€ ; sans compter une enveloppe de 550 M€ dédiée au volet non-ferroviaire. Donc ce sont là de très belles idées, mais il ne faut pas tromper nos concitoyens en leur faisant miroiter des projets qui demeurent encore à financer. J'ai le sentiment qu'en ce moment, le sujet des mobilités urbaines est devenu marginal dans le débat national. Plus personne n'en parle, ce qui est inquiétant.

© Beview. Tisséo Collectivités - Séquences architecture et urbanisme - Tisséo Ingénierie
Ligne nouvelle du Sud-Ouest (LGV Toulouse-Bordeaux) et Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) : pour quelles raisons soutenez-vous ces projets ferroviaires et quels seront leur impact sur vos territoires respectifs ?
M. D. : La LNMP est stratégique pour trois raisons. Elle permettra tout d’abord de renforcer le cadencement ferroviaire entre Béziers et Montpellier en améliorant les mobilités du quotidien sur ce sillon ; l’un des plus empruntés au niveau national et qui est soumis à une vulnérabilité climatique. Deuxièmement, nous devons honorer la parole de la France en respectant l’accord signé en 1988 portant sur la LGV Madrid-Paris. Les Espagnols ont tout réalisé alors que nous Français n’avons pas terminé cette connexion. Son achèvement représente donc un enjeu de compétitivité pour la France et plus localement pour Perpignan. Enfin, si nous voulons soutenir l’activité économique du pays, il ne faut surtout pas jeter à la poubelle les solutions qui ont marché par le passé. Financer des grands projets comme celui-ci, c’est donner de l’activité, de l’emploi et préparer l’avenir. Avec tous les élus concernés, je suis mobilisé. Une grille de financement a d’ailleurs été actée prévoyant un engagement des collectivités jusqu’en 2070. Il faut faire cette ligne qui est indispensable !
J.-L. M. : Soyons francs : c'est le point faible de Toulouse. Nous sommes la seule capitale régionale française à ne pas être desservie directement par la grande vitesse pour relier Paris. Nous sommes donc évidemment très engagés dans le projet de LGV Toulouse-Bordeaux, qui dispose d'un plan de financement clair - 40 % de l’État, 40 % venant de 25 collectivités territoriales et 20 % de l'Union européenne – et dont les travaux sont déjà engagés, à la fois au nord de Toulouse et au sud de Bordeaux. L'enjeu, à horizon 2032, est de relier Paris en trois heures et d'accompagner les trains du quotidien en désaturant le nœud ferroviaire toulousain, ce qui est d'ailleurs une condition pour que le Serm voie le jour. Le projet est enclenché, mais nous demeurons bien entendu vigilants, car nous entendons que l’État respecte et honore sa parole.
Vous pilotez vos collectivités dans un contexte budgétaire contraint, lié notamment à la baisse des dotations de l’État. Comment poursuivre les investissements en ces temps chahutés ?
M. D. : Les temps sont chahutés et incertains. À en croire les annonces du Premier ministre, les collectivités locales devraient participer à l’effort de redressement des comptes publics à hauteur de 5,3 Md€. Cela signifie moins de services publics de proximité et une fragilisation de l’investissement local qui est créateur d’emplois et de richesse, notamment fiscales. Chacun doit comprendre que cela va impacter des projets pouvant améliorer le quotidien. J’espère que ces choix ne seront pas mis en œuvre avec des conséquences difficiles. Je rappelle également qu’à la différence de l’État, les collectivités locales doivent présenter des budgets à l’équilibre. Notre niveau d’investissement sera donc moins important que ce qu’il a été. Et comme je l’ai évoqué avec l’offre de transport, notre Métropole a beaucoup investi. Aujourd’hui, la stratégie qui est la nôtre consiste donc à tirer parti de ces investissements qui ont bénéficié aux acteurs économiques. L’un des enjeux est d’avoir un relais auprès des investisseurs privés qui génèrent de l’activité économique. Les Métropoles doivent donner un cap à ces opérateurs à l’heure où il est difficile d’en identifier un au niveau national.
J.-L. M. : Je suis très inquiet quant à l'avenir des finances locales, et encore plus de celles des métropoles, qui subissent une ponction plus forte de la part de l’État. Tout comme Michaël, je vis tout cela de manière très injuste. Car la situation financière catastrophique dans laquelle se trouve l’État n'est pas due à nos collectivités. Depuis un demi-siècle, l’État s'est accordé chaque année ce qu'il nous interdit de faire : la possibilité de voter des budgets en déficit. Je suis inquiet, car on nous annonce au niveau national une ponction de 5,3 Md€ en 2026, ce qui est le double de celle opérée en 2025, qui était déjà très pénible et nous avait forcé à prendre des mesures d'économies dont nous nous serions bien passé. Si tout cela se confirmait, nous serions dans l'obligation de différer certaines opérations, de réduire le volume de nos investissements, au détriment de l'emploi, de la qualité de vie des habitants et de la nécessaire transition écologique.
Vos deux Métropoles ont signé en 2024 un nouveau pacte de coopération. Quel en est l'objectif et quelles sont les premières réalisations concrètes ?
M. D. : Même s’il existe de la compétition entre nos deux métropoles, il était important d’être dans un modèle de coopération, de partage et d’échange. Cet accord que nous avons renouvelé traduit l’idée que nous pouvons travailler ensemble sur de nombreux sujets et échanger sur les défis à relever. Nos élus, nos équipes se rencontrent pour mieux faire au service de nos habitants. Cet accord a permis d’identifier ce que nous pouvions faire ensemble dans le cadre de cette coopération. Exemple, dans le domaine de la culture, avec nos deux orchestres. Récemment, celui de Toulouse a participé au festival Radio France de Montpellier. C’est aussi le moyen de dire à la Région Occitanie comment nos deux Métropoles se positionnent en faisant valoir nos spécificités, notamment dans le cadre de l’élaboration de son Sraddet (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, NDLR). Avec Jean-Luc, nous ne sommes pas de la même sensibilité politique mais partageons le sens de l’intérêt général en travaillant ensemble dans un esprit de dialogue et de concertation.
J.-L. M. : Dès 2015, j'ai souhaité qu'il y ait un dialogue et une coopération entre nos deux métropoles. Cela avait été mis en place à l'époque avec le prédécesseur de Michaël et nous avons poursuivi après 2020 ces échanges ensemble, en définissant des sujets d'intérêt commun, comme la transition écologique, la promotion économique, l'emploi, l'innovation, la recherche, les mobilités durables, la démocratie participative, mais aussi la politique de la ville, le tourisme et la culture. Nos deux métropoles travaillent dans un esprit de coopération, au lieu de s'ignorer, de se regarder en chien de faïence ou, pire, de se combattre. Cela n'exclut pas la compétition, bien entendu, car elle fait partie de la vie !

Jean-Luc Moudenc et Michaël Delafosse lors de la signature du pacte de coopération entre les Métropoles de Toulouse et Montpellier le 19 avril 2024 à l'Opéra de Montpellier
© Cécile Marson / Montpellier Méditerranée Métropole
Quelle place doivent selon vous occuper les métropoles de Toulouse et de Montpellier dans l'équilibre territorial global en Occitanie ?
M. D. : Je mets en garde le discours public opposant les territoires entre eux ; c'est contre-productif. Les métropoles sont des locomotives, des lieux de création de richesse et d’emploi. L’un des enjeux est de travailler à l’équilibre territorial. Quand nous défendons nos dossiers LGV, nous défendons leur connexion à différents réseaux à l’échelle européenne, nationale et locale. Les Serm sont des espaces qui nous permettent de travailler avec les autres territoires. Nous avons une exigence de travailler en réseau et en complémentarité. Exemple en matière de santé : le CHU de Montpellier assure des consultations à Lodève (34) ou à Millau (12). Nos métropoles doivent accompagner les autres territoires. Si ce n’est pas le cas, nous échouerons.
J.-L. M. : Nous partageons la même vision. Une métropole n'est pas un ensemble égoïste, auto-centré, qui ne penserait qu'à lui-même. C'est un moteur de croissance mis au service du développement du pays. L'Occitanie compte deux métropoles ; nous devons faire en sorte que leur dynamisme soit diffusé au-delà de leurs territoires respectifs. Je m'insurge moi aussi contre ceux qui fustigent les métropoles et exaltent la ruralité au lieu de mettre en avant la complémentarité des deux ensembles et de travailler au dialogue et à la convergence. Les métropoles n'ont rien de parfait, bien sûr. Mais les accabler serait une bêtise. Le volontarisme politique doit prévaloir ; il nous faut identifier les sujets sur lesquels nous pouvons travailler avec la ruralité dans une perspective de profitabilité mutuelle.